


Mes premiers plaisirs cinématographiques m’ont été offerts par des films programmés à la télévision, mais parfois mes parents m’envoyaient au lit tôt, trop à mon goût. En restant à l’écoute des films depuis la chambre, j’ai découvert l’espace dit « off ».
Pendant mon enfance, j’ai aimé regarder des films noirs et des comédies, parmi lesquels l’antidote à la tristesse le plus euphorisant que je connaisse : Chantons sous la pluie (Singin’ in the rain, Stanley Donen et Gene Kelly, 1952). Sans aucun doute, « Good mornin’ » peut adoucir toute trace souterraine de mélancolie.
À cette époque, mon genre de prédilection était le western. Je ne savais pas alors que certains de mes westerns préférés avaient été réalisés par Anthony Mann. Des années plus tard, ses cadrages, son tempo tranquille et sa concision dramatique m’ont paru d’une force expressive inhabituelle.
J’ai été très ému par Le miracle d’Anne Sullivan (The Miracle Worker, Arthur Penn, 1962). J’avais douze ans. Cela m’a fait sentir que le cinéma pouvait apporter des émotions presque épidermiques sans s’adresser à l’intellect. Et j’ai eu l’impression que, grâce à l’accès au langage, Helen Keller, la fillette sourde-aveugle, naissait pour la deuxième fois.

Tierras lejanas (Anthony Mann, 1954)

L’homme de Laramie (Anthony Mann, 1955)

The Miracle Worker
Au même âge, un jour en rentrant de l’école, j’ai vu Rouges et Blancs (Csillagosok, Katonák, Miklós Jancsó, 1967), qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale dans la puszta hongroise. Cela m’a paru une bizarrerie, je n’ai rien compris mais, malgré sa froideur, j’ai été captivé par la chorégraphie de ses mouvements de caméra. J’ignorais qu’on appelait cela des plans séquences.
Et Jancsó utilisait ici l’une des plus belles combinaisons visuelles que l’on puisse imaginer : le format scope en noir et blanc. Robert Rossen a fait le même choix pour renforcer le drame dans L’Arnaqueur (The Hustler, Robert Rossen, 1961) que j’ai beaucoup aimé peu de temps après.
Un ou deux ans plus tard, j’ai vu Pas de printemps pour Marnie (Alfred Hitchcock, 1964) face auquel j’ai perçu que la caméra et la couleur permettaient d’explorer certaines zones troublantes de notre être, jusqu’à atteindre quelque chose dont je ne connaissais pas le nom : l’inconscient. De plus, pour la première fois, la version originale sous-titrée me permettait de savourer un concert de voix dans une langue différente.
Pendant que mes proches dormaient, la version originale, écoutée à faible volume, est devenue un plaisir clandestin réitéré, grâce à la programmation des Ciné Clubs d’Antenne 2 et du Cinéma de Minuit de FR 3. Oui, alors je vivais en France. Le passage télévisé de La salle de musique (Jalsaghar, Satyajit Ray, 1958), trois ou quatre ans plus tard, a été mémorable pour moi. Sous le regard du cinéaste bengali, dont j’ignorais jusqu’au nom, le passage hypnotique du temps anesthésiait la raison et le quotidien se chargeait de sensualité.

The hustler

Crin Blanc

Jalsaghar
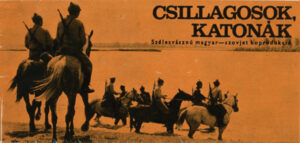
Rouges et blancs
Très sensoriel était aussi un moyen métrage que j’ai vu, je crois, à neuf ans dans la cour de l’école, pendant qu’il pleuvait : Crin Blanc (Crin Blanc, Albert Lamorisse, 1953). Je l’ai oublié pendant de nombreuses années, bien que je suppose que je me sois identifié au jeune Folco capable de chevaucher le pur-sang indomptable dans les dunes de Camargue.
Si j’ai appris quelque chose concernant la notion de mise en scène, c’est parce que j’ai eu la chance de voir Les Oiseaux (The Birds, Alfred Hitchcock, 1963) à treize ans. Mon admiration pour cette audacieuse épiphanie, heureusement dépourvue d’explication rationnelle, proche de l’abstrait et assaisonnée de suspense, n’a jamais diminué.
Ensuite, j’ai vu Un condamné à mort s’est échappé (Un condamné à mort s’est échappé, Robert Bresson, 1956). En vérité, je ne me souviens pas de ce que j’ai ressenti face au tranchant d’un contrôle artistique aussi acéré, bien que l’espace sonore et les ellipses se fondaient de manière miraculeuse dans une mosaïque de plans très fragmentés.
Pendant l’adolescence, j’ai commencé à voir beaucoup de films sur grand écran. Parmi les chocs les plus profonds, on trouve dix ou quinze films américains, rudes et vitaux, tournés pendant les années soixante-dix. J’ai également été fasciné par la minéralisation du monde filmée par Antonioni, les fresques de Visconti et son utilisation picturale de la couleur. Et certains visages féminins ont laissé une empreinte indélébile, tout comme leurs silhouettes et leurs voix.

The Birds

Un condamné à mort s’est échappé

Days of Heaven

Andreï Roublev
Parmi tous les films importants dans ma mémoire de spectateur naissante, je tiens à souligner deux : Les Moissons du ciel (Days of Heaven, Terrence Malick, 1978) et Tabou (F. W. Murnau, 1931), le premier avare en mots, le second silencieux, tous deux lyriques et situés dans une nature toute-puissante.
Mais par-dessus tout, je dois placer Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) et Andreï Roublev (Andreï Tarkovski, 1967), vus par hasard à peine dix-sept ans. Il va sans dire que ma vie de spectateur a pris un tournant et que je continue de considérer le dernier épisode du film de Tarkovski (la fonte de la cloche) comme l’un des moments les plus beaux de l’histoire du cinéma.
Ensuite, j’ai essayé de me donner du temps pour connaître et comprendre le cinéma.
Et puis j’ai commencé à écrire et à filmer…